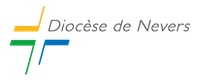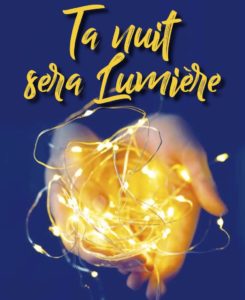Actualités
Rencontre nationale des responsables diocésains d’aumôneries d’hôpitaux
Une fois n’est pas coutume !
A l’Espace Bernadette à Nevers,
les 2 et 3 juin derniers, une rencontre nationale des aumôniers diocésains d’hôpitaux a rassemblé une soixante de ces aumôniers, venus de toute la France,
pour réfléchir sur le « burn-out ».
Pourquoi ce thème ? Parce que des responsables en aumônerie avaient, en amont, exprimé leurs difficultés à assumer une mission certes d’une grande richesse, mais parfois lourde.
Trois intervenants étaient présents : Marie-Françoise Bonicel, psychologue et psychothérapeute ; Philippe Clémençot, psychothérapeute et professionnel de l’édition ; Père Jean-Marie Onfray, théologien moraliste
Les apports à 3 voix ont été très vivants !
Définition et symptômes:
Définition: Le “burn-out” (mot évoqué pour la première fois en 1969, qui signifie brûler, se consumer, s’éteindre), est un état d’épuisement généralisé, souvent physique et psychique, qui perturbe gravement la personne atteinte dans sa vie personnelle et professionnelle ; il s’agit d’une surcharge physique ou psychique, à laquelle on se trouve incapable de faire face, et qui cause des douleurs diverses, du découragement, de la déprime, voire même des signes de dépersonnalisation, et jusqu’à parfois des idées suicidaires. Lors d’un burn out, l’organisme se met en mode survie »
Symptômes : stress, apathie, nervosité, hypo ou hypervigilance, troubles de l’attention, de la concentration, obsessions, irritabilité, impatience, sentiment d’échec, découragement, démotivation, dépression, culpabilisation, colère, anxiété, angoisse, déni, isolement….
Deux approches :
- Appréciative : il s’agit d’interroger les acteurs sur ce qui leur apporte de la satisfaction, ce dans quoi ils se sentent compétents ou heureux ; de repérer les réalités qui sont des richesses ; de se focaliser sur des données qualitatives (approche, écoute…) ; on prête attention au constructif, plutôt qu’au négatif….
Présente des avantages dans une approche plus individuelle pour remotiver
et valoriser les ressources personnelles
- Contextuelle : le contexte de ce cadre est un tissu relationnel entre le donné et le reçu qui tisse la trame de la confiance ; des effets dégradants, défavorables, par manque de considération mutuelle ou par déséquilibre de la balance, peuvent mettre en cause la qualité des transactions ….
Objectif : restaurer ou instaurer une confiance entre acteurs
4 mots importants à retenir pour notre mission:
- Projet : se redire régulièrement notre projet ; utiliser les bons éléments pour le réfléchir (boîte à outils) et être bien au clair ; quel projet portons-nous ?
- Représentation : comment mettons-nous en scène nos représentations ? nous ne dialoguons pas assez sur nos représentations (la lettre de mission est un acte d’engagement, avec une notion de responsabilités) ; la représentation de réalité physique est plus facile que la représentation de réalité spirituelle…pas toujours facile de rendre compte de ce qui est en jeu (et non du quantitatif !) dans un rapport d’activités
- Capital : « si tu savais le don de Dieu » ; on ne mesure jamais assez le capital que nous avons reçu (nous avons reçu grâce sur grâce, dit St Paul) ; maintenons-le vivant, notre capital n’a d’intérêt que s’il est actif
- Reconnaissance : sachons-nous dire merci, et reconnaître ce que font les autres dans nos équipes ? sans grands discours, il s’agit plus d’une manière d’être…
Lors du burn-out, on baisse les bras ; la souffrance spontanée (non conscientisée) ne va pas suffire ; il faut permettre à la personne de réaliser ce qui lui arrive ; elle a besoin d’une certaine qualité d’écoute ; sa souffrance est salutaire si elle est exprimée, parce que la personne n’est plus passive devant ce qui lui arrive ; il est question de vigilance pour l’autre et pour soi-même ; jusqu’où peut-on aller ? Réinterroger régulièrement ses limites ; prise de conscience et expression (qui soit communication) sont indispensables !
Nous avons répondu, en petits groupes, à un questionnaire sur ce qui est agréable et ce qui est douloureux dans notre mission :
- « L’agréable » peut se vivre dans la rencontre d’une humanité blessée ; nous sommes témoins de la révélation de l’autre à lui-même ; c’est aussi le respect de la dignité de l’autre
Notre mission permet de donner le visage d’une Eglise qui va vers les autres ; nous fait vivre l’hospitalité ; dans la rencontre, il se passe toujours quelque chose
La relecture est un moment important et agréable, de même que le partenariat (donner priorité des présences d’Eglise auprès des soignants)
Autre côté constructif : accompagner la formation et faire réussir
Quant à la solitude, elle est positive ; ne la fuyons pas, c’est la grâce du moine…
- « Le douloureux » se vit dans l’échec de la relation, qui nous rappelle le risque de la relation ; savoir dire non (d’où l’intérêt de nos oui !) est douloureux ; difficulté aussi avec les fins de mission….
Autres douleurs : la routine, la lassitude, la violence de la mort, l’impuissance (et pourtant c’est une grande richesse parce que nous ne recherchons pas la toute puissance) ; la non-reconnaissance ; la solitude subie
Des résolutions ?
Evoquer du « constructif » ; prendre soin de soi ; et inciter ceux dont on est responsable à prendre soin de soi aussi ; avoir un réseau de solidarité, pour une préoccupation fraternelle ; lever le pied peut libérer, et faire avancer les choses parfois à notre insu ; entretien individuel pour déterminer et évaluer la qualité des relations : les + et les – ; et évaluer ensemble les moyens de progression ; attention de ne pas devenir esclave d’internet ; prévenir ou repérer ce qui peut être une aide et, pour cela, faire un travail de deuil et arriver à accepter que l’on se passe de nous ; si usure, retirer le meilleur de certaines personnes pour investir le meilleur d’autres
Le burn out sous le regard la foi
Deux catégories de démarche dans l’Evangile :
- le « tout-venant », celui qui vient vers Jésus sans le savoir (la femme qui touche son manteau ; « ta foi t’a sauvée» ; foi dans le tactile, le toucher ; n’est pas dans une dynamique vocationnelle
La foi se dit et la foi se voit ; d’où une confiance en nous, comme Jésus sur les routes de Galilée ; comme si notre présence remettait les personnes debout ; sans être un lieu de catéchèse, mais un lieu de rencontre pour susciter cette émergence de confiance. Et
- les disciples et les apôtres (à ne pas confondre avec le tout-venant), qui ne sont pas dans cette foi visible, mais dans une foi écoute, une foi réponse ( vocare) : les disciples et apôtres se reconnaissent appelés, à la différence des tout-venants ; nous sommes missionnés pour faire de l’autre des humains, pas des chrétiens…
Tout l’ancien testament est marqué par ce désir d’appeler ; nous avons la liberté de dire non, l’acte de foi n’est pas obligatoire ; notre réponse est libre et continument libre !
Chaque jour, Jésus nous redemande si nous voulons le suivre , il nous faut entrer dans la disponibilité « parle, ton serviteur écoute » ; écoute d’un tuteur….
Quelle est notre capacité à L’écouter ? Notre écoute peut aller parfois jusqu’à l’écoute du silence ; présence parlante ; silence gros d’espérance, de présence
Etre très patient dans l’écoute du Seigneur pour que çà résonne (et non raisonne)
Joie de la rencontre de Jésus ; de quand date notre dernière rencontre avec Jésus qui nous a remis debout ? chaque rencontre avec Lui est une renaissance…..Dieu fait de nous de nouveau des vivants ; comment laisse-t-on résonner la parole de Dieu ?
LA VOCATION
Toute vocation est toujours exode, et m’emmène vers un autre pays, me fait quitter des terres d’esclavage ; est promesse (Pape François) ; un autre que moi-même donne sens à mon existence ; faire émerger ce sens ! Cette dynamique d’exode nous grandit en humanité, nous mène vers la dynamique pascale ! Entrer dans l’acceptation que ce chemin soit aussi celui qu’a pris le Christ
Le désir de Dieu est de nous donner la vie en abondance ; comment nous mettre à l’écoute de Celui qui structure notre existence pour découvrir que la parole nous fait sortir de nous-même et nous ouvre à une vie en abondance ? Le chemin de vocation est un chemin fécond ; même si nous sommes affrontés à des choses lourdes à porter dans notre mission…
Enjeu avec le tout-venant : comment être une présence discrète pour qu’il puisse faire une expérience de foi
Prendre le temps de découvrir que nous voulons devenir disciples, se remettre régulièrement en situation (“Parle, ton Serviteur écoute”)
Au nom de notre mission et au nom de notre vie, sachons prendre du temps pour redevenir disciples,
et nous laisser façonner par sa parole
Et ainsi être capable de répondre à « que veux-tu que je fasse pour toi ? »
Lui dire que je veux devenir disciple, que j’ai besoin de Lui pour voir plus clair, pour entendre, pour être meilleur ; pas seulement une logique d’efficacité s’appuyant sur mes propres forces
LA MISSION
Toute vocation est mission ! Notre mission est participation à la mission de Dieu : instituer une alliance avec l’homme, et instaurer un royaume de justice et de paix ; c’est mettre nos pas dans ses pas, vivre à la manière de Dieu (simplicité, fragilité, vulnérabilité)
L’Eglise se fait conversation, en dialogue ! Dieu n’a pas de stratégie, nous non plus ! C’est la présence au monde « il est venu chez les siens » et l’attention aux plus petits « ce que vous avez fait aux plus petits, c’est à moi que vous l’avez fait » ; cette présence doit diffuser ; notre existence est missionnaire, nous sommes des « personnes mission » (Pape François)
Avant d’être, la mission est un « donné » à contempler;
nous sommes des contemplatifs
L’Eglise a besoin de définir des missions particulières, mais toutes sont temporaires, pour un temps donné ; nous avons à les vivre en étant nous-mêmes, en étant disciples, en n’existant que dans la fragilité. Ne pas confondre fécondité et efficacité ! C’est dans la fragilité que Dieu est Dieu, tel qu’il s’est révélé. Importance de rendre compte de la mission à l‘évêque ou au vicaire général pour qu’ils se rendent compte (et rendre grâce pour çà !) de ce que l’on vit
Une tâche pastorale n’est pas une carrière ; ne peut être que dans un temps donné, et liée à une mission donnée
Comment conjuguer responsabilité en Eglise et fraternité….